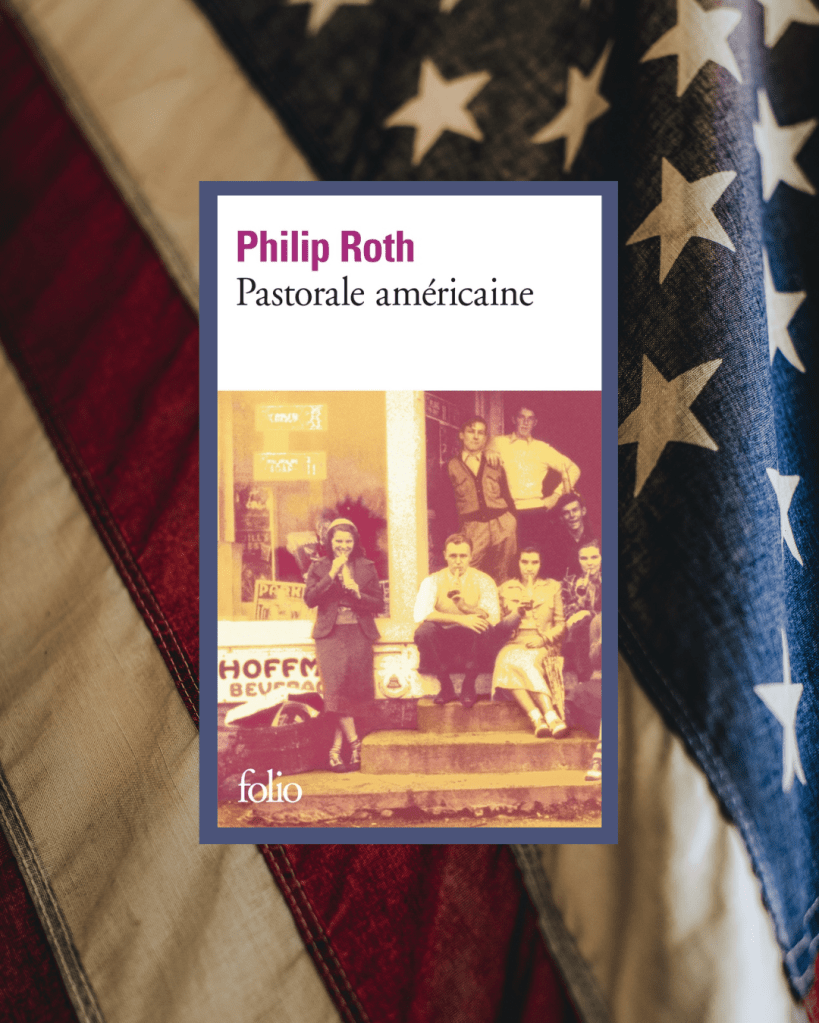
L’écrivain Nathan Zuckerman se souvient à quel point, au lycée déjà, tout réussissait à Seymour Levov : fils d’immigrés juifs surnommé « le Suédois », blond et beau, athlétique, adulé par les filles, intelligent (et modeste avec ça !). Avec le temps, sa success story l’élève presque au niveau du mythe, sa vie ressemble à une « pastorale américaine » : heureux en affaire, il a épousé Miss New Jersey 1949 et acquis une propriété champêtre idyllique où est née une petite fille aussi blonde que lui. Une existence lisse et sans aspérité, à l’abri – du moins jusqu’à ce que cette fille devenue adolescente la pulvérise en commettant un acte effroyable. Tombant des nues lorsqu’il l’apprend, Zuckerman cherche à comprendre et, faute d’éléments tangibles, en est réduit à spéculer sur ce qui a pu se jouer derrière la façade…
Ce roman m’a déconcertée, fascinée et, il faut bien l’admettre, donné l’impression de m’être fait rouler dans la farine.
Parce qu’on a forcément à notre tour le réflexe de chercher des explications, des éléments déclencheurs susceptibles d’avoir fait dérailler un destin doré. En tant que parent, c’est l’horreur absolue d’imaginer que notre progéniture puisse dévier à ce point et en venir à commettre des actes aux antipodes de nos valeurs les plus fondamentales. Alors comme le narrateur est hyper doué et sa spéculation totalement immersive, j’y suis rentrée à fond, partageant la douleur du Suédois et cherchant désespérément à mettre le doigt sur l’élément perturbateur : défaillance parentale ? Famille secrètement dysfonctionnelle ? Traumatisme déclencheur ? Répercussions individuelles des convulsions de l’Amérique, de la violence déployée au Vietnam, de frictions intergénérationnelles ? Roth est très fort (et très cruel) parce que tout en provoquant cette soif de rationaliser chez son lecteur en nous invitant à envisager des explications – quitte à devenir franchement intrusifs ! –, son roman finit par nous faire comprendre à quel point cette aspiration est illusoire. J’ai mis du temps à réaliser qu’il s’agit ici moins des drames qui font bifurquer une existence que de ce que nous faisons tous lorsqu’un tel drame se produit : construire des récits pour le rendre plus supportable. D’ailleurs, construire des récits, c’est ce que nous faisons sans cesse, y compris d’ailleurs aussi face à des formes de réussite et de succès. Et en la matière également, le Suédois offre une sacrée surface de projection.
Vous vous demanderez peut-être quel est l’intérêt, sur le fond, d’une spéculation sur les moindres rouages d’une histoire somme toute fictive ? Je me suis parfois posé la question en cours de route mais rétrospectivement, j’ai mesuré la puissance du dispositif.
Avant tout, l’expérience dessine un monde chaotique où l’existence est susceptible de basculer au gré d’infimes hasards, d’alchimies psychologiques et sociales imprévisibles, ou d’inflexions induites par ce qui se joue au niveau collectif et politique. La vie n’a pas de sens. Les êtres les moins répréhensibles peuvent voir le sol se dérober sous leurs pieds. Symétriquement, la pastorale américaine apparaît, elle aussi, comme une fiction dont les fissures ne résistent pas à l’examen minutieux déployé dans le roman. Le grand récit qui sort le plus écorné de ces pages, c’est bien l’American dream, le mythe du melting pot et l’idée que l’on pourrait se prémunir du chaos ambiant par une existence honnête et méritante, bien symbolisée par le motif récurrent du gant : le rêve d’une vie bien ajustée, propre, protégée de l’extérieur.
La réflexion concerne aussi la nature et les effets des récits. Un récit bien raconté, c’est terriblement persuasif. Roth s’y connaît et use de ce pouvoir. La spéculation de Zuckerman atteint une densité inouïe, parfois déconcertante, se laissant aller à digresser pendant des pages sur la fabrication des gant, les émeutes qui dévastent Newark, le concours Miss America 1949 ou la généalogie du voisin pour remonter jusqu’en 1770… Tout cela crée l’illusion d’un narrateur omniscient alors qu’il s’agit d’une extrapolation à partir de bribes d’informations. Happé par le récit tout en ayant conscience que son magnétisme tient à la force de la narration (puisque les faits énoncés ne sont pas vraiment étayés), on se retrouve dans une position étrange qui invite à méditer sur les pouvoirs de ce qui se raconte, même quand ces récits font totalement violence à leurs protagonistes.
Les digressions et détails contribuent aussi à reconstruire, autour du personnage du Suédois, un concentré des États-Unis des 1960s : un pays saturé de récits identitaires, obsédé par l’antériorité, les origines et les appartenances. La généalogie interminable du voisin, par exemple, ramène le Suédois à son milieu d’immigrés juifs qui doivent prouver leur bonne intégration et consolider leur respectabilité. Ainsi, en donnant une telle épaisseur à son décor, Roth montre comment la société américaine travaille diffusément l’intime jusqu’à fracturer sa propre pastorale.
Pastorale américaine est donc une lecture paradoxale qui m’a fait passer par une succession d’états contradictoires : sensation de fissure, frustration, intense cogitation, admiration du dispositif, méditation sur la puissance de ce que ces pages dévoilent de l’humanité et de la société étasunienne.
Lu en janvier 2026 – Édition Poche chez Folio, 9,99€
Une lecture qui semble faire cogiter les lecteurs et de bien des manières. Quant à spéculer sur une histoire fictive, c’est pour moi la preuve qu’elle est bien construite.
J’aimeAimé par 1 personne
Effectivement, la construction est magistrale ! Merci d’être passée par ici !
J’aimeAimé par 1 personne
Tu me donnes envie de le relire avec un œil plus affûté que quand je l’ai eu pour la première fois entre les mains !
J’aimeAimé par 1 personne
Je ne relis presque jamais de romans (parce que ma pile de romans encore jamais lus déborde autant) mais je suis sûre que Pastorale américaine est de ceux où cela vaut vraiment le coup. À chaque fois que je l’ai refeuilleté après ma lecture pour écrire mon billet, j’ai eu l’impression de découvrir de nouvelles choses 🙂
J’aimeAimé par 1 personne
Tu sembles aimer les romans sur l’histoire americaine contemporaine et sa sociologie, et tu sais donner envie. Alors après Paul Auster, je me note Philip Roth.
J’aimeAimé par 1 personne
Merci pour ta confiance ! Effectivement, ce sont deux auteurs qui ont beaucoup en commun – nés dans le New Jersey, créatifs dans leur manière de raconter des histoires, doués pour tisser une fresque américaine à partir de vies individuelles. J’espère vraiment qu’ils te convaincront autant que moi !
J’aimeAimé par 1 personne
En tout cas, je les ai notés. Jai même acheté Auster, alors il n’y a plus qu’à. C’est le côté brique qui me fait repousser et attendre le moment propice ^^
J’aimeJ’aime