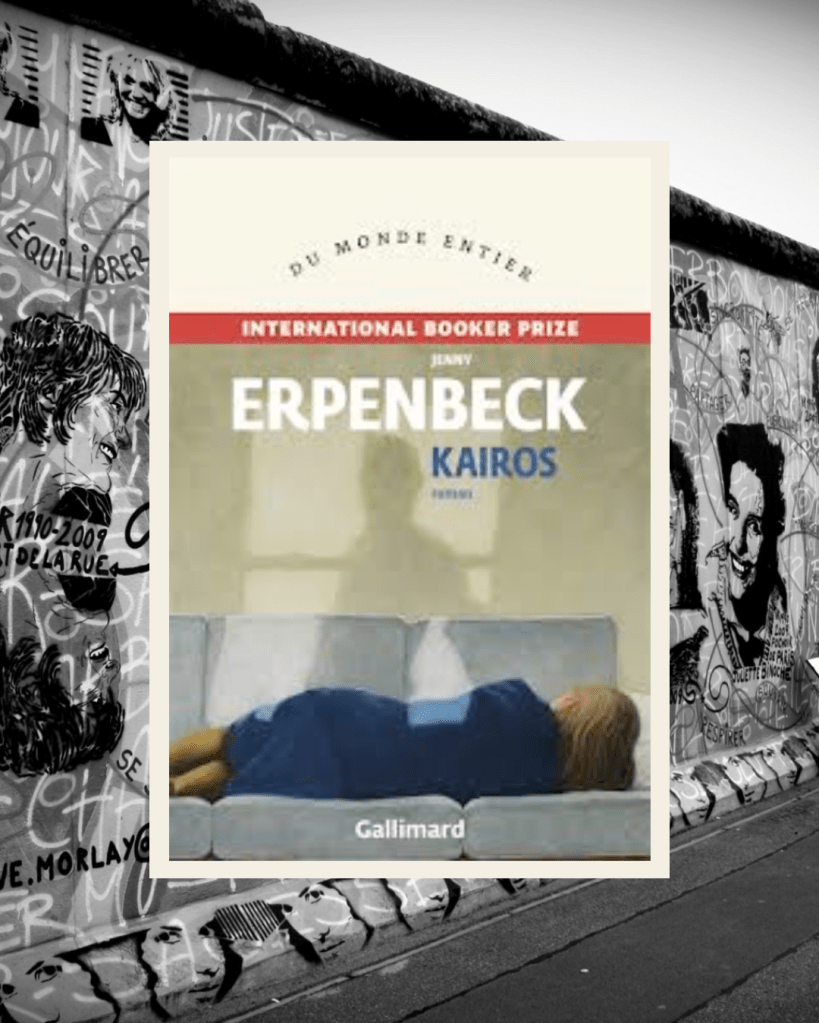
Quelques jours après la mort d’un certain Hans parviennent à Katharina deux cartons au contenu troublant : lettres, notes, photos et objets divers réveillent le souvenir intense et douloureux de sa relation avec Hans, dans le monde révolu du Berlin-Est de la fin des années 1980…
Entre la jeune femme de dix-neuf ans et l’écrivain de cinquante-trois, le coup de foudre est immédiat. Mais autant vous le dire tout de suite, cette romance, je ne la sentais pas. Ce n’est pas tant l’écart d’âge (34 ans tout de même) ni la situation d’adultère (même si inviter Katharina dans le lit conjugal n’était pas hyper classe), mais plutôt l’asymétrie qui plombe la relation dès le départ : le décalage entre ce que l’un et l’autre projettent dans l’idée du grand amour ; la façon dont elle le trouve brillant et fascinant, tandis que lui voudrait se gorger de sa beauté juvénile, de sa fraîcheur et de sa déférence. La naïveté de Katharina la livre entièrement à la relation qui s’installe ; l’expérience de Hans, au contraire, lui permet d’en anticiper les étapes, d’en conscientiser les ressorts, d’en dicter le cadre et de parvenir à ses fins tout en se couvrant. Bref, cette histoire n’a rien d’émoustillant, elle m’a même rappelé ce que décrit si bien Nathacha Appanah dans La nuit au cœur.
Sans doute est-ce précisément l’effet recherché, et si tel est le cas, Jenny Erpenbeck réussit son coup. Son roman dissèque les glissements successifs qui précipitent un couple vers un terrain toxique, montrant notamment très bien comment les blessures d’enfance, les désillusions et les humiliations altèrent la manière d’aimer et nourrissent une soif de contrôle destructrice. C’est éprouvant et j’aurais parfois aimé pouvoir accélérer la lecture pour échapper au sentiment d’étouffement qui m’oppressait. Mais c’est aussi très bien fait, porté par un style, sobre, presque clinique, conjugué au présent, qui se prête à cette autopsie sentimentale. Les répétitions et les longueurs qui m’ont parfois pesé restituent implacablement les spirales de pensée obsessionnelle et la claustrophobie émotionnelle des personnages. L’enroulement de leurs fils de pensée, la superposition de leurs monologues intérieurs révèlent l’étendue des décalages et l’ambiguïté de la relation amoureuse. « L’amour et la haine se ressemblent », dit Hans en contemplant la frise du Grand Autel de Pergame : une phrase qui pourrait servir de boussole à tout le roman.
On pourrait lire aussi cette relation comme une métaphore des idéaux socialistes au fondement de la RDA, que l’on voit se déliter en arrière-plan. La ferveur sincère et presque absolue des débuts repose sur un projet ambigu qui nourrit peu à peu la désillusion, la violence, l’effritement des êtres jusqu’à leur anéantissement. La manie des personnages de vouloir mythifier et commémorer les pages de leur histoire fait par exemple écho à l’appareil symbolique du régime est-allemand. La soif de contrôle de Hans rappelle évidemment aussi la surveillance obsessionnelle exercée sur les Allemands de l’Est.
Ce qui m’aura le plus marquée dans Kairos, c’est la contre-perspective essentielle qu’il oppose aux récits enchantés de la chute du Mur et de la réunification. On ressent la pesanteur de l’appareil d’État autoritaire, l’omniprésence des monuments et slogans socialistes, l’apathie politique et la frustration de se sentir enfermé, mais on réalise aussi que l’Ouest ne fait pas autant rêver que ce que nous aimerions penser. Lorsqu’elle rend visite à sa grand-mère à Cologne, Katharina voit les rues commerçantes qu’on lui montre avec fierté, mais elle voit surtout les mendiants auxquels de ce côté du mur, tout le monde semble s’être habitué. Elle entre par hasard dans un sex-shop et reste figée sur le seuil : est-ce donc cela, la liberté, l’expression brute des désirs humains ? Quant au tournant de novembre 1989, il est raconté sans s’appesantir sur les images euphoriques du mur qui tombe. Un monde s’effondre pour beaucoup d’Allemands de l’Est sans que l’Ouest ne leur propose grand-chose en retour. Ils resteront avec le sentiment d’avoir été annexés, rachetés, secourus peut-être, mais pas véritablement intégrés à une Allemagne réunifiée.
La plume d’Erpenbeck fond en un seul et même tout les pensées des personnages, les souvenirs surgis de l’enfance national-socialiste de Hans, les rêves, certaines paroles d’opéra et références littéraires, ou encore la description de phénomènes physiologiques ou chimiques à l’œuvre chez les personnages. C’est exigeant, parfois même fatigant. Un motif revient avec insistance : celui des morts gisants sous terre – ceux du IIIᵉ Reich, du bolchevisme, de la RDA – qui hantent Hans. Ainsi, les personnages semblent évoluer sur les strates d’histoire allemande multiples et douloureuses qu’a produites le 20e siècle.
Kairos n’est donc pas un roman confortable, mais une lecture dense qui montre subtilement, mais sans fard, une emprise amoureuse et idéologique en train de se défaire.
Lu en décembre 2025 – Version originale en allemand chez Penguin Verlag, 14€
Et ta critique rend parfaitement justice à ce livre dont il est si difficile de parler.
J’aimeJ’aime
Rien qu’avec l’écart d’âge et l’adultère, c’est un grand non pour moi !
J’aimeJ’aime